Maté Gutfreund (qui francisera son nom en Mathieu Matégot) né en Hongrie en 1910, au sein d’une famille de la petite noblesse rurale. Après des études à l’Ecole des Beaux-Arts de Budapest, il débute en 1929 sa carrière comme peintre de décors de théâtre avant de fuir le conformisme culturel du régime autoritaire de l’amiral Miklós pour voyager en Europe et aux Etats-Unis. Installé à Paris en 1931, il enchaîne divers postes à vocations artistiques et créatives : créateur de décors pour les Folies Bergères, étalagiste aux Galeries Lafayette, styliste pour des maisons de couture (...) et s’initie à la tapisserie et la création de meubles et d’objets en métal et rotin.
Ebloui par les propositions des décorateurs à l’Exposition internationale des Arts et Techniques de 1937, Matégot décide d’embrasser lui aussi le retour à l’excellence artisanale française pour façonner des pièces en fer forgé. S’il ne poursuivra pas cette voie, se confronter au métal et ses possibilités sera déterminant pour la suite d’une carrière, qu’interrompt la Seconde Guerre Mondiale. Engagé volontaire pour son pays d’adoption, Matégot sera membre de la Résistance et fait prisonnier de guerre en Allemagne, découvrant durant son emprisonnement les possibilités de la tôle de fer. De retour à Paris après une évasion en 1944, il s’entreprend à créer des meubles et des tapisseries .
Pour son œuvre parallèle de mobilier métallique, Matégot entretient à partir de 1946, une entreprise de cinq salariés à Montrouge. Bénéficiant du soutien de la galerie La Crémaillère pour cette production atypique, il intensifie son activité au début des Années 50 pour s’imposer dans le milieu de la décoration.
Encore inspirés par les formes classiques, ses meubles d’alors (parmi lesquels les modèles "Cap d’Ail") déclinent des tôles perforées de trèfles quadrilobés et laquées de couleurs vives. Exposées aux sein des différents Salons, ces créations sont remarquées pour leurs lignes élégantes et leurs proportions harmonieuses et adaptées aux exigences des habitats plus exigus de l’après-guerre. Fort de ces premiers succès critiques et commerciaux, Matégot déplace son atelier de Montrouge dans le XIXe arrondissement de Paris, d’où il pourra laisser libre cours à sa créativité tout en maitrisant sa production et sa commercialisation.
Sensible aux impératifs d’une économie fragilisée autant qu’à la recherche de fraîcheur et de nouveauté en décoration, l’artiste fera le choix de produire en petites séries, notamment pour son mobilier qui sera confié à des distributeurs ou des décorateurs pour leur diffusion. Ce faisant, Matégot peut se renouveler à loisir, et c’est ainsi qu’il troue ses feuilles de métal de petits carrés de 1950 à 1951 avant d’imaginer en 1952 le "rigitule", une fine tôle perforée de petits trous circulaires. Devenue sa signature, cette "dentelle métallique" qu’il façonne comme un tissu fera l’objet d’un brevet avant d’évoluer de 1953 à 1959 vers le "rigibande" : des bandes de tôle parallèles aux perforations plus larges (comme dans sa série "Santiago") et/ou plissées comme pour les modèles "Java". Homme de son temps et chercheur infatigable, Mathieu Matégot alliera souvent son métal à d'autres matériaux comme le rotin, le cuir ou la céramique en collaboration avec son ami Georges Jouve.
En dépit de son succès, Matégot met fin à son parcours de designer au début des années 60, cédant sa société à ses associés (qui l’exploiteront jusqu'en 1964 pour se consacrer à la seule production de tapisserie. Son œuvre textile connue à ce jour énumère 629 tapisseries originales comme autant "d’architectures linéaires et colorées, d'un parfait équilibre."
Dentelier métallique et fonctionnaliste joyeux, Mathieu Matégot s’éteint en 2001. Libre de toute école, son héritage est celui d’un artiste polyvalent, à l’inspiration féconde et maîtrisant remarquablement les savoir-faire artisanaux. Son vocabulaire formel où le métal devient "transparent", aérien et coloré lui sert encore de signature aujourd’hui en étant immédiatement reconnaissable.

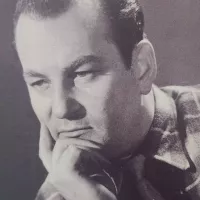
![[DESIGN]--779941-3646-img1 [DESIGN]--img1](/s3/files/styles/square_max_all/public/auction-items/779941-3646-img1-design.jpg.webp?itok=SVzNQrdB)






